de Cloé Korman.
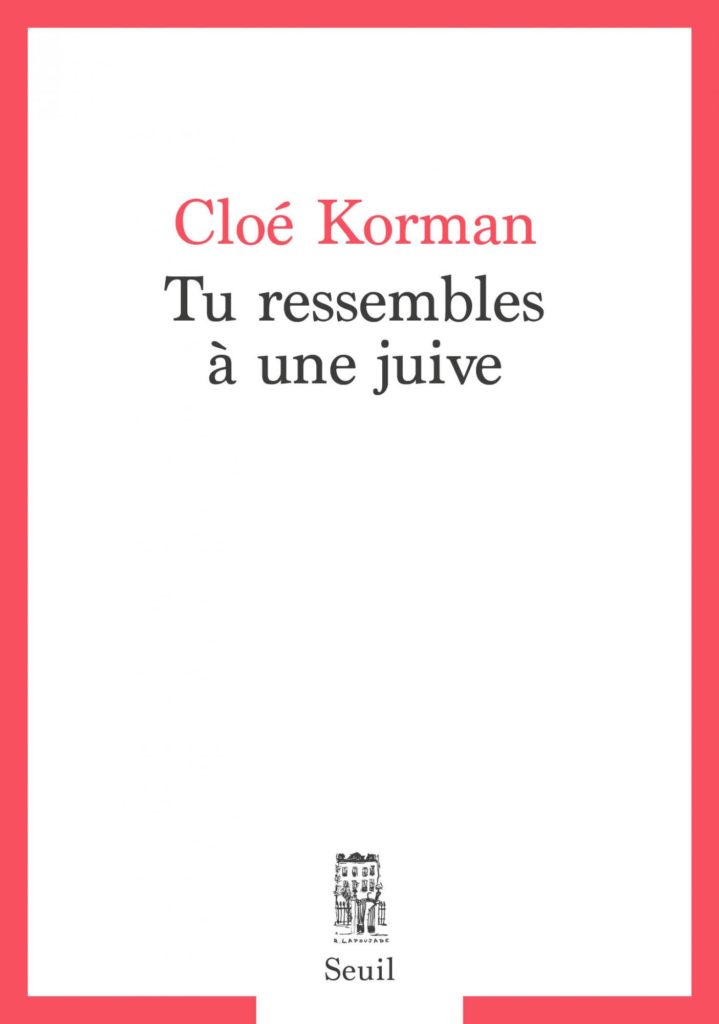
Remarquable, ce texte l’est autant par la force de l’intervention que par la subtilité d’une écriture constamment attentive à s’arrimer au sensible — à dire le détail des expériences. Marquant son attachement à une « identité juive laïque et embrouillée », Cloé Korman définit précisément le lien entre une telle identité et une dimension diasporique irréductible, qui inlassablement vient inquiéter toute entente assurée — satisfaite — de ce qu’« identité » veut dire. C’est ainsi se donner les moyens non seulement de déterminer certains traits spécifiques de la haine antisémite (laquelle vise les juifs au moins autant, sinon plus, « pour leur mélange à l’intérieur des autres territoires et des autres cultures qui les ont accueillis » que « pour leur culte, leurs traditions »), mais encore de faire en sorte qu’une telle connaissance, loin de se replier sur une dénonciation isolée, fournisse le puissant levier d’une déconstruction générale de la grammaire du racisme, et par là des formes multiples, des plus évidentes aux plus retorses, de son inscription dans les esprits.
S’il est une expérience de la judéité qui, comme Perec l’a noté dans les Récits d’Ellis Island, consiste à se sentir étranger non pas tant aux autres qu’à soi, alors Cloé Korman trouve dans cette expérience même l’impulsion irrépressible d’un appel à lutter collectivement contre la violence des assignations identitaires.
Gilles
Il me semble indispensable de défendre un judaïsme athée, intellectuel, un judaïsme qui assume son caractère mélangé aux autres cultures, aux autres pays… Il est l’allégorie d’une certaine forme d’étrangeté, pour moi inséparable de l’expérience littéraire : une étrangeté radicale vis-à-vis du langage et de la société, et qui rend sensibles leur caractère fabriqué et leurs abus.
Cloé Korman, Tu ressembles à une juive, Éditions du Seuil, 2020.
